Université Chouaib Doukkali : « L’enseignement-apprentissage du français au Maroc au XXIème siècle. Vers de nouveaux enjeux? », thème d’un nouvel ouvrage
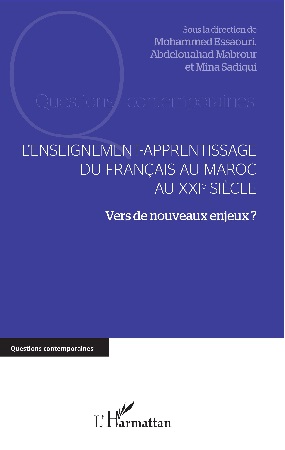
Mohamed LOKHNATI
La scène linguistique du royaume vient d’être renforcée par la parution d’un nouvel ouvrage intitulé « L’enseignement-apprentissage du français au Maroc au XXIème siècle. Vers de nouveaux enjeux? », fruit des contributions de nombreux professeurs spécialisés en la matière, après plusieurs mois de recherches et de dures labeurs.
La question des langues, dans un contexte plurilingue comme celui du Maroc, n’interroge plus uniquement le degré de continuité entre les cycles de notre système éducatif, même si la frontière entre ces derniers est très mince. Les nouveaux enjeux que cette langue peut et doit mobiliser, aux niveaux pédagogique et socio-économique, ainsi que les conditions dans lesquelles s’effectue son enseignement/apprentissage en tant que langue utilitaire, langue de spécialité, langue d’enseignement ou encore et tout simplement langue vivante permettant de rencontrer l’Autre, tous ces nouveaux enjeux sont déterminants pour son appropriation.
Quelle influence la politique linguistique et éducative au Maroc, foncièrement liée à l’ambiguïté du statut de cette langue dans notre système éducatif, a-t-elle sur les pratiques de classe ? Les dispositifs pédagogiques conçu et mis en œuvre sont-ils en adéquation avec la réalité des apprentissages visés ? Quelles difficultés rencontrent les différents acteurs pour proposer des modalités d’enseignement efficaces et adaptées aussi bien aux besoins du public ciblé qu’aux différents contextes de son enseignement/apprentissage – du primaire à l’universitaire en passant par le secondaire ?
Les contributions de quelques 17 professeurs chercheurs réunies dans cet ouvrage proposent une diversité des approches en fonctions des différents contextes (primaire, secondaire, universitaire, formation des enseignants)…
Les principales questions, donc, auxquelles cet ouvrage s’efforce d’apporter des éléments de réponse concernent principalement :
A- Les contraintes institutionnelles qui pèsent sur l’emploi et l’enseignement de cette langue,
B- Les besoins actuels et futurs en apprentissage de cette langue
C- Son statut actuel (de droit ou de fait) : langue de scolarisation ?, langue « seconde » ?, langue « privilégiée » ?, langue « prioritaire » ?, langue « obligatoire » ?, langue « étrangère ?, langue en relation avec les autres langues …,
D- Les objectifs (linguistiques, culturels, communicatifs, interculturels, …) qui lui sont assignés,
E- Les dispositifs didactiques et approches pédagogiques mis à l’œuvre pour son enseignement ainsi que l’intérêt que représentent les TIC dans l’enseignement des langues (matériaux d’enseignement porteurs de contenus, enseignement hybride, à distance,…),
F- Le rôle que peut jouer l’enseignant-(chercheur) et le formateur dans ce processus en tant que « diagnosticien », « planificateur », « animateur », de l’enseignement (utilisation du matériel, savoir-faire pédagogique), et l’importance de la formation continue dans la pratique pédagogique.
Force est de rappeler aussi qu’entre autres professeurs ayant contribué à cet ouvrage, Mohamed Essaouri, Abdelouahad Mabrour, Mina Sadiqui, Jean-Paul Narcy, Combès, Rachid Saadi, Anas Elgoussari, Brigitte Lepez, Claude Cortier, Malika Bahmad, Naïma El Berkaoui, Hosni Menari, Nathalie Spanghero-Gaillard,Amal Sfaira, Arnaud Pannier, Marlène Lebrun, Sanaa Bassotoun et Daniel Bart.








